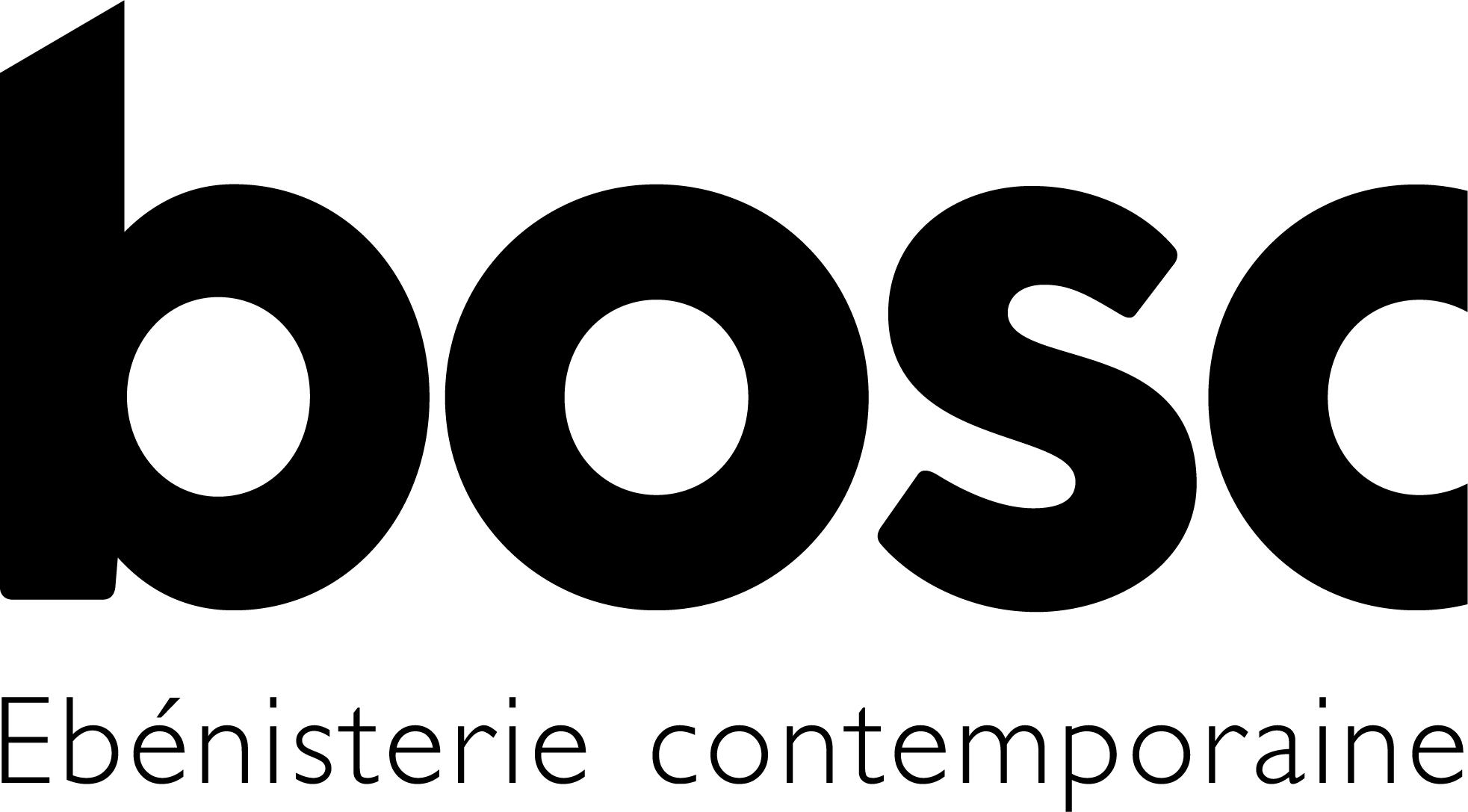Maximalisme : le retour du « more is more »?
Après des années de sobriété scandinave, de blanc immaculé et de « less is more » érigé en dogme, quelque chose bouge dans nos intérieurs. Les réseaux sociaux débordent de salons bariolés, de papiers peints à motifs audacieux et de mélanges de styles qui auraient fait frémir les puristes du minimalisme il y a encore quelques années. Alors, simple effet de mode ou véritable révolution décorative ?

L’ère du minimalisme touche-t-elle à sa fin ?
Pendant presque une décennie, nos maisons se sont vidées. Marie Kondo a fait le tri, les influenceurs nous ont vendu du blanc cassé à tout-va, et nos intérieurs ont ressemblé à des galeries d’art contemporain. Fonctionnel, certes, mais aussi parfois froid et impersonnel. Cette esthétique du dépouillement, née de l’engouement pour le design nordique et amplifiée par Instagram, semble aujourd’hui montrer ses limites.
Car vivre dans un décor épuré, c’est beau en photo, mais au quotidien ? Entre les enfants qui traînent leurs jouets colorés et l’envie croissante de personnaliser son cocon, le minimalisme parfait devient difficile à maintenir. Sans compter que dans les années post Covid et des mois de confinement, beaucoup ont ressenti le besoin de réchauffer leur intérieur, de lui donner plus d’âme.
Les signaux d’un changement de cap
Sur Pinterest et TikTok, les tendances parlent d’elles-mêmes : le « grand millennial style » cartonne avec ses chintz fleuris et ses bibelots assumés. Le « dark Academia » nous fait redécouvrir le charme des bibliothèques surchargées et des ambiances feutrées. Même le kitsch retrouve ses lettres de noblesse avec des intérieurs pop, colorés et décomplexés. Les jeunes générations, en particulier, semblent rejeter l’uniformité du tout-blanc. Elles revendiquent des intérieurs qui racontent une histoire, mélangeant vintage et contemporain, multipliant les textures et les couleurs. L’authenticité prime sur la perfection instagrammable.
L’hôtellerie ouvre la voie


Cette tendance ne se limite pas aux intérieurs privés. L’industrie hôtelière, toujours en quête de différenciation, a été l’une des premières, il y’a quelques années, à embrasser cette nouvelle esthétique. Exit les lobbies aseptisés aux tons neutres, place aux hôtels-boutiques qui osent la couleur et la personnalité.
Le Hoxton à Paris mélange velours colorés, papiers peints vintage et mobilier chiné dans une ambiance cosy-chic assumée. À Londres, le Zetter Townhouse joue la carte du bric-à-brac raffiné avec ses salons surchargés de tableaux, objets anciens et tissus à motifs. Ces établissements misent sur une expérience immersive plutôt que sur une beauté froide et uniforme. Même les chaînes internationales s’y mettent : W Hotels développe des concepts toujours plus audacieux, mélangeant art contemporain, couleurs vives et mobilier décalé. Les styles, les époques se superposent avec, selon les cycles, une prédominance de certaines époques. L’objectif ? Créer des espaces « instagrammables » qui marquent les esprits et génèrent du buzz sur les réseaux sociaux.
Les espaces tertiaires suivent le mouvement

Dans le monde du bureau aussi, les codes évoluent. Les entreprises tech, les start-ups mais aussi les cabinets d’avocats et les agences créatives redécouvrent les bienfaits d’environnements plus chaleureux et stimulants.
Google et ses bureaux colorés ont fait école, mais aujourd’hui même des secteurs plus traditionnels osent l’originalité. Des cabinets comptables installent des bibliothèques murales, des fauteuils en velours et des luminaires vintage pour créer une atmosphère plus accueillante. L’idée ? Que les collaborateurs se sentent bien dans un environnement qui leur ressemble. Les espaces de coworking comme WeWork ont popularisé cette approche « homy » du bureau, avec leurs canapés confortables, leurs plantes vertes et leurs œuvres d’art locales. Résultat : les frontières entre maison et bureau s’estompent, et l’esthétique maximaliste trouve naturellement sa place dans ces nouveaux environnements de travail.
Maximalisme : art de vivre ou simple réaction ?

Ce retour du « plus » ne signifie pas pour autant un retour aux excès des années 80. Le maximalisme d’aujourd’hui est plus réfléchi, plus maîtrisé. Il s’agit moins d’accumuler que de créer des environnements riches en émotions et en références personnelles. Les architectes d’intérieur observent cette évolution avec intérêt. Certains y voient une maturité nouvelle dans l’approche décorative, d’autres une simple oscillation du balancier des tendances. Car après tout, la décoration a toujours fonctionné par cycles : aux années 70 psychédéliques ont succédé les 80 minimalistes, puis les 90 éclectiques.
La vraie question n’est peut-être pas de savoir si le maximalisme revient, mais plutôt comment il se réinvente. Les codes changent : on privilégie la qualité à la quantité, on mixe les époques avec discernement, on crée des « controlled chaos » où chaque élément a sa place. Cette nouvelle approche maximaliste semble plus durable que ses prédécesseurs. Elle répond à un besoin profond de personnalisation et d’expression de soi dans un monde de plus en plus standardisé. Nos intérieurs redeviennent des refuges personnels plutôt que des showrooms impersonnels.
Finalement, ce mouvement traduit peut-être une aspiration plus large : celle de retrouver de la chaleur humaine dans nos espaces de vie. Après avoir découvert l’art du vide, nous redécouvrons celui du plein – mais un plein choisi, pensé, qui nous ressemble. Le maximalisme version 2026 ne sera probablement pas celui de nos grands-parents. Il sera digital, éco-responsable et assumé. Entre minimalisme et maximalisme, peut-être que l’avenir se dessine finalement dans l’équilibre et la liberté de choisir ce qui nous fait vraiment vibrer chez nous.