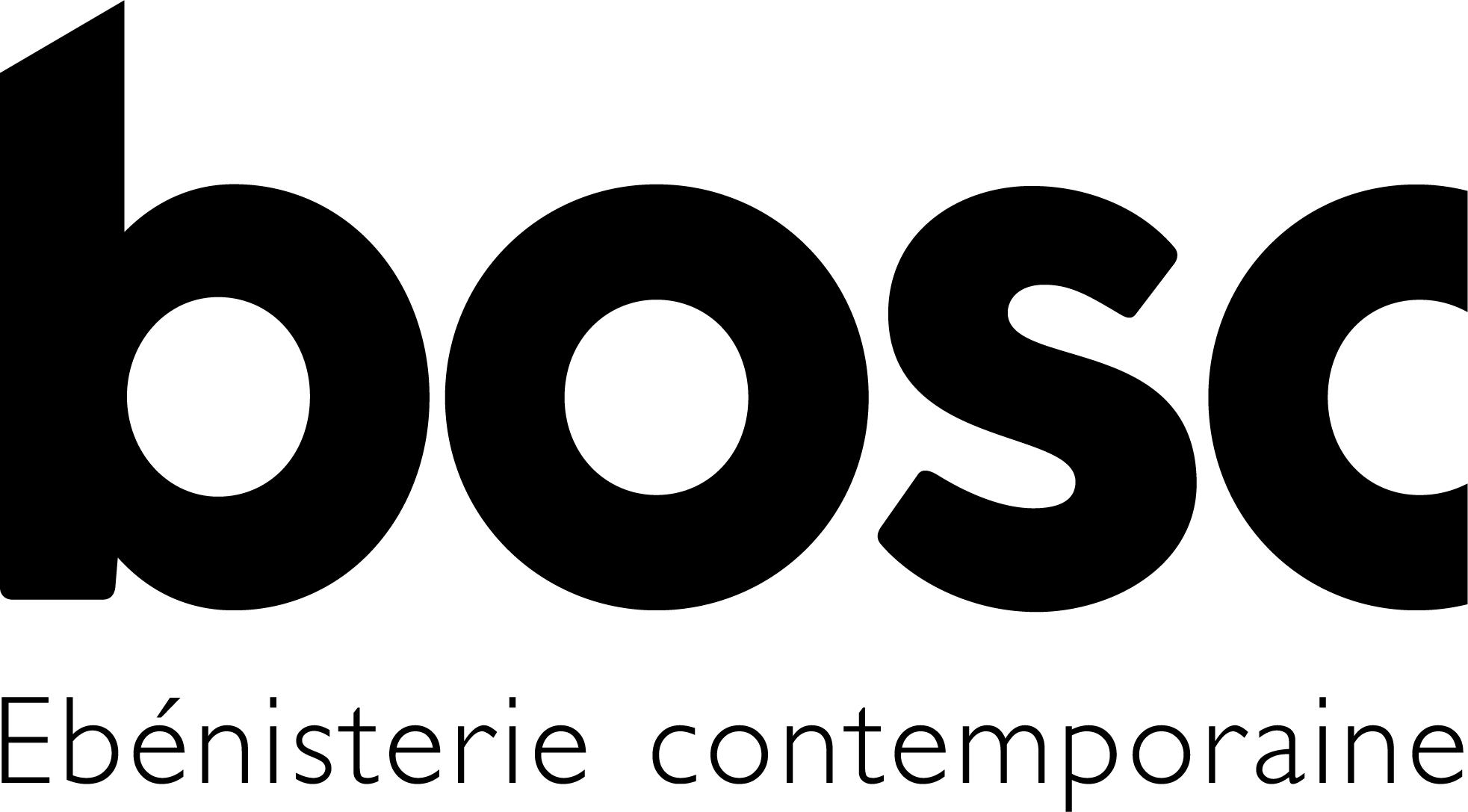Penser contre soi-même : Une éthique de la dissidence dans l’architecture intérieure des lieux d’hospitalité
« Il faut penser contre soi-même », affirmait Gilles Deleuze, reprenant à son compte une injonction de Michel Foucault. Ce mot d’ordre ne se limite pas à la sphère abstraite de la philosophie. Il s’agit, bien plus profondément, d’une méthode pour lutter contre les évidences, les automatismes, les routines mentales – bref, tout ce qui rend la pensée paresseuse. Alors pourquoi ne pas appliquer cette posture à un domaine apparemment éloigné de la critique : l’architecture intérieure ? Pourquoi ne pas faire de cette injonction une ligne de conduite pour concevoir les hôtels, les restaurants, les espaces de travail ?

D’un confort normatif à une esthétique critique
À première vue, architecture d’intérieur et dissidence ne font pas bon ménage. Le métier est en partie façonné par le désir de confort, de bien-être, d’adéquation aux usages. Dans les hôtels, on cherche l’uniformité apaisante ; dans les restaurants, la chaleur d’un « cadre agréable » ; dans les bureaux, l’efficacité ergonomique. Mais cette quête de confort est souvent une couverture élégante pour une profonde normalisation de l’expérience. Le philosophe Theodor Adorno parlait « d’industrie culturelle » pour désigner cette tendance à produire des formes artistiques ou culturelles qui flattent les attentes du public au lieu de les interroger. Il y a une industrie du design d’intérieur qui, de la même manière, reproduit à l’infini des codes stéréotypés conditionné par des briefs truffés de « mots valise » en les faisant passer pour de la créativité.
Penser contre soi-même, ici, consisterait à résister à cette tentation de l’évidence formelle et normative. Ne plus voir l’utilisateur comme une donnée psychologique à satisfaire, mais comme un être pensant, capable d’être surpris, déstabilisé, transformé par l’espace qu’il traverse. Plaire n’est pas penser et créer un espace qui ne déstabilise jamais, c’est parfois faire l’économie du sens. Et si résister à ses propres habitudes de création consistait peut être à refuser la répétition de codes qui fonctionnent, mais qui ne disent plus rien. De nombreux architectes ne cèdent pas à la commande sans l’interroger. Un client veut « un hôtel chaleureux et moderne » ? Très bien. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Quelle modernité ? Quelle chaleur ? Et si on proposait autre chose, quelque chose qui le confronte à une autre manière d’habiter l’espace ? Dans un monde où la valeur de l’espace est souvent réduite à sa photogénie ou son ROI (retour sur investissement), la pensée critique devient un luxe — mais aussi une nécessité. Elle permet de réintroduire de la complexité, de la temporalité, et pourquoi pas, un peu d’ironie dans des lieux souvent trop sérieux pour leur propre bien.

La pensée critique comme moteur du projet spatial, l’hospitalité comme acte de résistance douce
Dans la pratique du design intérieur, cela suppose un travail d’auto-sabotage – au bon sens du terme. Se méfier de ses propres goûts. Se demander si ce que l’on conçoit est juste, et non seulement efficace ou beau. Loin du dogme moderniste du « form follows function », il s’agirait de renouer avec une conception éthique de la forme : ce que cette forme fait à ceux qui la vivent via des dispositifs radicaux : parois translucides, absence de mobilier conventionnel, rapports volontairement troubles entre intérieur et extérieur. Des lieux qui ne vous caressent pas dans le sens du poil, mais qui vous éveillent même si il est vrai que penser contre les attendus programmatiques pour laisser place à l’indétermination est une liberté que peu de commanditaires offrent aux architectes d ’intérieur.
Penser contre soi-même dans l’architecture des lieux d’hospitalité ne veut pas dire refuser l’hospitalité. Bien au contraire. Cela revient à redéfinir ce que veut dire « accueillir ». Non pas simplement offrir un abri agréable, mais proposer une expérience sensible singulière, un espace qui invite au ralentissement, à la conscience du lieu, au décentrement. Dans ce cadre, des designers comme Ilse Crawford (Studioilse) travaillent précisément à cette frontière entre confort et trouble : ses intérieurs ont une beauté imparfaite, une lumière parfois trop douce, une matérialité presque archaïque. Elle parle d’ »emotional ergonomics », une approche où la conception spatiale devient l’occasion d’explorer notre rapport affectif au monde – et non de le fuir. La notion d’hospitalité radicale développée par l’anthropologue Michel Agier trouve ici un écho : accueillir, c’est exposer à l’altérité. C’est refuser la dissolution de tout lieu dans une esthétique mondialisée. Et c’est peut-être cela, le plus beau geste d’architecte : refuser de tout lisser.

Dans les espaces tertiaires : penser contre l’efficacité
Dans les espaces de travail aussi, penser contre soi-même suppose de refuser le diktat de la productivité à tout prix. L’open space n’a rien de neutre. Il est l’héritier d’une idéologie de la surveillance douce, où la transparence devient contrôle (cf. les travaux de Michel Foucault dans Surveiller et punir). Créer un espace qui autorise le retrait, le repli, la non-interaction — ce n’est pas aller contre le travail, c’est penser une forme plus humaine de rapport au temps et aux autres. Certaines agences, comme Lagranja Design à Barcelone, ou encore Jakob+MacFarlane, expérimentent avec des zones non programmées dans les bureaux, des interstices flous qui échappent à la logique marchande. Des gestes simples mais radicaux : un banc sans fonction, un escalier qui devient salon, une alcôve acoustique au fond d’un open space.
Le design comme critique incarnée
Dans un monde dominé par le « design d’ambiance », où Pinterest et Instagram dictent les tendances, penser contre soi-même devient un acte de résistance professionnelle. C’est refuser la facilité du béton ciré et du bois blond, questionner la prolifération des plantes suspendues, interroger la manie des luminaires sphériques. Non pas pour le plaisir de provoquer, mais pour retrouver une liberté d’invention et de narration dans l’espace. Penser contre soi-même, pour un architecte d’intérieur, c’est peut-être accepter qu’un restaurant n’ait pas besoin de ressembler à un autre restaurant. C’est accepter d’introduire de l’inconfort, du silence, du vide. C’est remettre en jeu la fonction, la lumière, le son, et même le rythme du lieu.
Ce qui se joue ici dépasse la simple esthétique. Il s’agit de faire du design un lieu de pensée. Non pas en théorisant après coup, mais en incarnant des tensions dans la matière, dans la circulation, dans la lumière. En osant la dissonance, le silence, le non-saturé. Penser contre soi-même, c’est éviter l’adhésion immédiate. C’est créer un moment de friction qui peut ouvrir à une conscience accrue du lieu – et donc du monde. On peut donc envisager l’architecture intérieure comme une poétique de la résistance douce. Une manière de lutter, non pas contre le client ou l’usager, mais contre l’uniformisation de l’espace. Penser contre soi-même, c’est penser pour autrui autrement. Et peut-être, dans un monde saturé de confort simulé, cela devient-il la forme la plus authentique d’hospitalité.
Références
Gilles Deleuze, Foucault, 1986.
Michel Foucault, Surveiller et punir, 1975.
Theodor W. Adorno, Minima Moralia, 1951.
Michel Agier, L’Étranger qui vient : repenser l’hospitalité, 2018.
Matali Crasset, Le design comme attitude, divers entretiens.
Ilse Crawford, Sensual Home, 2000 ; articles du Studioilse.
Écrits critiques sur l’open space : Franck Cochoy, Le paradigme de la transparence